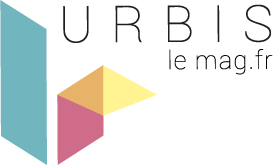L'urbanité, ce bien public

Le projet mené autour de la redécouverte de la rivière Cheonggyecheon, à Séoul, a permis de créer de l’égalité en mettant à disposition de tous les habitants un bien public de qualité.
En lice pour le Grand prix de l'urbanisme 2017, le géographe Jacques Lévy affirme avec force le caractère politique de l'urbanisme et la possibilité de transformer l'espace urbain qui en découle : « Même et surtout dans une société complexe, il est possible d'avoir de grandes ambitions, à condition d’écarter l'unilatéralisme dans la prise de décision et de privilégier la coproduction des projets le plus en amont possible ». Le texte qui suit est extrait d'une conférence donnée par Jacques Lévy à Dunkerque à l'occasion des dernières universités d’été du Conseil français des urbanistes.
« On peut dire que l'urbanisme consiste à fabriquer de l'urbanité et que l’urbanité est un bien public, coproduit par de nombreux acteurs, parmi lesquels les urbanistes et les habitants. Un bien public est un bien ouvert à un nombre illimité de consommateurs sans que cela lui fasse perdre de sa valeur. On peut ajouter que les biens publics, comme l'éducation, la santé, la culture sont coproduits par leurs bénéficiaires directs et la société dans son ensemble. On peut définir l’urbanité comme un bien public puisque d’une part, il profite à tous et, d’autre part, il implique la participation active de ceux qui justement en profitent. Nous savons que l'espace public ne se réduit pas à l'urban design : vous pouvez faire un très beau cadre avec de jolies façades, un joli sol et un joli mobilier urbain mais si il n’y a personne, ce ne sera pas un espace public, ce sera une tentative ratée d'espace public. De même, dans la culture, vous pouvez faire de musées magnifiques et gratuits, mais si seuls les gens déjà très cultivés le fréquentent, ce ne sera pas un bien public culturel, seulement un dispositif de reproduction de l’existant.
Cette approche, qui contient une dimension éthique et nous parle aussi de justice, nous incite à rompre avec le paradigme caritatif : la redistribution a des limites, les pauvres ont aussi des responsabilités dans le processus de sortie de la pauvreté, une responsabilité qui n’exempte personne, mais dont personne ne peut se décharger. Au-delà de la discussion sur les principes, dans un pays comme la France où la dépense publique porte sur 57% du PIB, ce n’est pas une question abstraite.
Acteurs parmi d'autres acteurs
Là où nous, qui travaillons sur l'espace, pouvons apporter notre pierre à ce débat, c’est en notant que nous manipulons et nous contribuons à produire des biens qui ne se réduisent pas à une composante monétaire et qui entrent dans des échanges qu’on ne peut pas penser comme des jeux à somme nulle, comme la proximité ou l’éloignement, la mobilité, l’urbanité, l’habiter. Cette spécificité nous permet de comprendre pourquoi nous somme à l’aise avec la notion de bien public. Nous nous voyons acteurs parmi d’autres acteurs, non parce que nous dévalorisons notre travail, mais parce que nous sommes conscients que les autres comptent beaucoup. Une étude, publiée dans la revue Urbanisme en 2011, intitulée « La ville qu'ils veulent, la ville qu’ils font » rendait compte d’un travail de modélisation réalisé par le laboratoire Chôros. Dans une ville imaginaire, mais assez réaliste, où les catégories sociales et la carte des prix du sol rappelait des situations européennes, nous avions, dans chaque groupe social, des allophiles, qui acceptaient de résider dans des quartiers sociologiquement mixtes, et des allophobes, qui optaient pour l’entre soi, tout cela en respectant les contraintes de l’espace existant et les limites de leur pouvoir d’achat.

Le modèle a fabriqué des villes sans urbanistes, uniquement configurées par l’action volontaire des habitants. Le résultat nous a impressionnés : avec une majorité d’allophiles, on obtient une ville compacte ; avec une majorité d’allophobes, on a un espace urbain étalé et fragmenté. Et même si on ajoute des politiques publiques d'aide aux familles ou d’actions urbaines, qui diminuent l’écart des prix du foncier entre le centre et la périphérie, les allophones utilisent ces mesures pour créer des espaces homogènes.
On ne changera pas la ville contre les habitants
Ce genre de modélisation invite à la modestie. On ne changera pas la ville contre les habitants. Cela ne signifie pas pour autant que les positions soient figées pour l’éternité. Regardons les effets concrets massifs de ce qu’on peut appeler la conscience écologique. Un phénomène idéel a déplacé les lignes et a rendu possible ce qui était impensable peu de temps avant. Les citoyens-habitants sont, plus que jamais, capables d’apprendre, de changer, de s’engager – mais rien ne se fera sans eux.
C’est une évidence mais je ne suis pas sûr qu’elle soit partagée par tous. Quand j'entends le mot acceptabilité, dans mon environnement souvent composé d’architectes ou d’ingénieurs, c'est un mot qui plait car il permet de bien distinguer les sachants et les ignorants. « Nous on sait et les autres ne savent pas, on va leur expliquer pour leur rendre acceptable ce qui, nous le savons, est bien pour eux. »
La conscience écologique a eu cet effet pervers de renforcer les hiérarchies entre ceux qui savent et les autres : certains chercheurs-militants sont tellement rigidifiés par leur posture axiologique combinée avec une tradition positiviste peu réflexive qu’ils rejouent avec les citoyens ordinaires une condescendance qu’on pouvait croire dépassée. Ils opposent les solutions rationnelles, qui seraient leurs, aux complots supposés de leurs adversaires et aux réticences de leur public, qui ne peuvent venir, pensent-ils, que des méandres obscurs de l’âme humaine. L’usage du mot « acceptabilité » traduit cette propension au surplomb : au lieu de considérer les citoyens comme des acteurs capables d’intelligence complexe et de réflexivité, on les traite comme des choses. L’usage du terme « comportement » (plutôt qu’opinion, attitude, point de vue, démarche…) complète le basculement de la sociologie dans l’éthologie, le déni aux citoyens de leur intentionnalité pour les enfermer dans l’univers des causes.
L'urbanisme est fondamentalement politique
On peut donc dire que l’urbanisme est une activité fondamentalement politique en ce que, à propos de l’habiter et de l’être-habiter, elle transforme la diversité du social en développement pacifique de la société.

Pour conclure, je voudrais vous parler de Cheonggyecheon, une rivière qui coule à Séoul. Cette ville avait à peu près 200 000 habitants en 1900 et en a 25 millions aujourd'hui. Le résultat est honorable, surtout si l’on se souvient des excuses qu’on donne aux expériences urbaines hasardeuses réalisées en Europe après 1945 au nom de l’urgence de la « Reconstruction ».
Cheonggyecheon était une rivière de banlieue, où les femmes du peuple lavaient le linge, puis qui est devenu un canal industriel pollué qu’il a fallu recouvrir et transformer en égout. On y a ajouté un viaduc autoroutier vite saturé. Cependant, en 2005, conseillé par des urbanistes modestes et déterminés, le maire de Séoul, a décidé qu'on ferait autre chose : on a démoli le viaduc, ouvert l’égout, nettoyé la rivière, pour en faire un espace public très fréquenté par les employés du centre-ville et qui est aussi la deuxième attraction touristique de la ville. Actif 24h sur 24 tout au long de l’année, il possède une diversité temporelle, avec des ambiances très variées selon la saison, le jour ou l’heure.
C'est aussi un espace organisé selon une séquentialité spatiale avec une part croissante du végétal au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre. Enfin, c'est une opération qui n'a pas coûté très cher et qui s'est faite en très grande concertation avec les acteurs concernés, y compris les petits commerçants et le lobby routier qui n'était pas favorable au projet au départ.
Oui, on peut transformer l'espace urbain !
La première leçon qu’on peut tirer de cet événement, c’est qu’on peut transformer l'espace urbain. Même et surtout dans une société complexe, il est possible d'avoir de grandes ambitions, à condition d’écarter l'unilatéralisme dans la prise de décision et de privilégier la coproduction des projets le plus en amont possible. Ensuite, cette action a changé en profondeur l’espace et est unanimement saluée par les habitants alors qu’elle a joué sur des liens sociaux faibles. On n’a pas touché aux réalités monétaires (revenus, État-providence, fiscalité…).
On a créé de l’égalité par la mise à disposition de tous d’un bien public de qualité, mais d'autres inégalités persistent et on ne peut en rendre coupable l’urbanisme. L'urbanisme et, au-delà, l’urbanité ne doivent pas porter le fardeau de toute la misère du monde. L’urbanisme n’est pas transcendant, il ne se soumet pas le reste et les autres, il est transcendantal : il rend possible.
Le Corbusier et Franck Lloyd Wright aimaient fixer les meubles au sol : ils savaient tellement bien quels étaient les besoins des résidents qu’il n’était pas nécessaire, pensaient-ils, d’envisager le moindre changement. Avec Cheonggyecheon, c'est le contraire : on en a fait le moins possible. Il n’y a pas de gestes esthétiques spectaculaires, on ne tient pas la main des usagers. L’urbanisme fabrique de l’égalité dans la liberté. Il propose un cadre optionnel aux habitants, et ce seront eux qui, tous parce que chacun, feront la ville et l’urbanité.
Pour penser cette puissante humilité, il faut des visionnaires d’un genre nouveau. Et qui peut l’être sinon les urbanistes ? Leur principal défaut, aujourd’hui, c'est d'être trop modestes, de confondre la nécessaire écoute des autres acteurs avec un excès d’effacement.
Il y a toujours une seconde chance
Je terminerai en reprenant une formule de Hannah Arendt : le politique vise à permettre que chaque moment soit pour les citoyens un commencement. Il y a toujours une seconde chance. Notre monde peut être étouffé par la patrimonialisation et symétriquement par la crise des futurs. Le patrimoine est une invention récente : il a fallu attendre 2 000 ans pour que l’on invente l’idée de trace et qu’on sanctuarise les objets du passé retrouvés et réinventés. Puis la patrimonialisation a rattrapé et dépassé le présent et elle est désormais partie intégrante de toute production nouvelle, avec un risque de congélation qui survaloriserait l’existant et dévaloriserait le possible.
Ce pourrait être une machine à tuer le futur, déjà mal en point face aux idéologies nostalgiques (« C’était mieux avant ») ou anti humanistes (« Le monde serait bien plus beau sans les humains »). L’urbaniste est le metteur en scène d’une pièce réunissant de nombreux personnages, dont le texte s’écrit en même temps qu’il se joue et dont le titre pourrait être : On commence maintenant. »

L’intégralité de la conférence de Jacques Lévy, intitulée « Qui construit la ville ? L’urbanisme comme médiation politique », est à retrouver dans l’ouvrage « Ville en partage – savoir, transmettre et partager la ville » que vient de publier le Conseil français des urbanistes.
Pour vous le procurer, rendez-vous sur le site du CFDU.